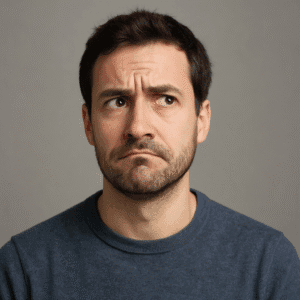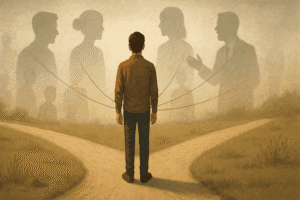Le sentiment « d’être nul(le) »

Je vous propose une rapide réflexion sur un sentiment que je croise bien souvent. Si je pars de mon expérience quotidienne, je dirais qu’il y a de nombreuses personnes pleines de qualités, par exemple sensibles et bienveillantes, qui vivent pourtant avec une impression sourde et tenace d’être nulles.
Le terme »nul » peut apparaître choquant, car il l’est, mais c’est pourtant le terme entendu directement dans les discours que les personnes concernées effectuent à propos d’elles-mêmes. Et les facettes jugées si durement sont multiples: par exemple, nulles dans leurs décisions, nulles dans leurs relations, nulles dans leur façon d’exister, nulles dans leur personnalité, nulles dans leur carrière, etc.
Ce sentiment n’est par ailleurs pas toujours aussi explicitement exprimé pour d’autres personnes, il peut s’insinuer et saboter les élans dans de nombreux domaines. Par exemple, ce sentiment diffus pourra murmurer en soi, au moment de se lancer dans une expérience ou un projet « tu ne vas pas y arriver » ou « tu ne le mérites pas »!
C’est ce type de sentiment qui peut aussi diffuser à bas bruit quand quelqu’un vous félicite « s’il savait vraiment, il penserait autrement »… Et bien souvent je le perçois aussi dans les discours à l’endroit des réussites de la personne: « j’ai juste eu de la chance!”
Même si je suis bien conscient que permettre à une personne de sortir des schémas auto-agressifs prend du temps et souvent nécessite un chemin thérapeutique, j’aimerais proposer, dans ce billet, à celles et ceux qui vivent avec cette perception d’eux-mêmes, que ce sentiment n’est pas une preuve et que ce n’est pas un fait objectif non plus!
C’est une mémoire émotionnelle, une empreinte ancienne et je vous propose ici quelques éléments permettant d’explorer
Insensibilité à la toxicité des relations ?

Partons de ce petit texte, largement diffusé sur les réseaux et qui met en avant une posture protectrice face à la maltraitance relationnelle:
« Si quelqu’un te traite mal, souviens-toi juste qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne, et non chez toi. Les gens normaux ne cherchent pas à détruire les autres. »
Quand on ce texte on peut se dire « c’est évident! » car si un voisin nous traitait mal, évidemment que la plupart des personnes ne seraient pas d’accord et comprendraient que le voisin a un problème pour agir de la sorte…
Mais cela ne devrait pas s’arrêter au voisin si je puis dire, car ce texte simple nous invite bien à voir le comportement toxique de l’autre en général, non pas comme un reflet de notre valeur, mais comme une expression des troubles ou des souffrances internes de cet autre.
Vous devinez peut-être où mon propos se dirige: il me semble que la majorité des personnes qui devraient être concernées directement par ce message ne le seront pas!
Oui, et c’est malheureux, la plupart des personnes concernées par la maltraitance lisant ce message ne font pas le lien direct avec une personne qui pourtant les maltraite! Un ou des parents, un ou une conjoint(e), un ou une ami(e), un ou des autres membres de la famille,…
Plus un lien affectif existe (ancrage d’attachement neurobiologique développé à l’enfance) et plus la victime semble devenir absente au message de résilience et de protection proposé par ce texte…
Précisons bien encore une fois que cela n’est pas une faute de volonté ni de courage, on ne le dira jamais assez.
Pour une personne empêtrée dans une relation dysfonctionnelle, il sera souvent nécessaire d’entreprendre un chemin thérapeutique pour pouvoir « vivre de l’intérieur » le message du texte proposé. Pourquoi? Parce que l’esprit et donc le cerveau se sont sans doute suradaptés, à l’enfance, à des systèmes toxiques et cette suradaptation a orienté les schémas de pensée dans un sens qui va servir les intérêts des abuseurs!
Quels mécanismes cognitifs et émotionnels suis-je en train de pointer du doigt? Passons-en quelques-uns en revue car ce sont eux qui maintiennent tant de personnes dans une posture de souffrance au contact de personnes toxiques.
Prenons l’angle des filtres cognitifs qui empêchent de prendre du recul: le biais d’attribution interne (c’est celui qui pousse à l’auto-culpabilisation): celles et ceux ayant grandi dans des environnements invalidants ou abusifs, ont pu »apprendre » par suradaptat
Réflexion: le passé influence-t-il nos choix?
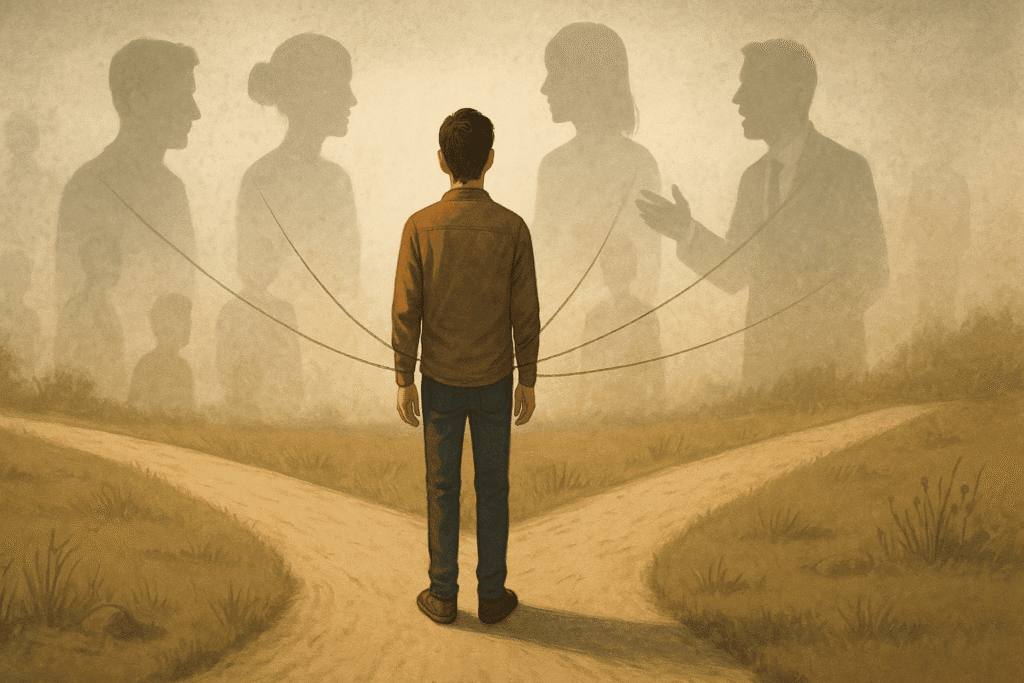
Je viens de lire cette phrase affirmative sur un réseau social:
« Tu n’imagines pas à quel point ton passé influence encore chaque choix que tu fais ».
Voici une réflexion personnelle à sa lecture.
J’ai toujours été intrigué (parfois même amusé, je l’avoue) par les affirmations péremptoires qu’on entend ici ou là: ”moi, je suis acteur de ma vie!” ou encore « je décide, je choisis, je trace mon propre chemin ».
J’y entends toujours une sorte de fierté existentielle, un engagement personnel qui m’apparaît émaner d’une volonté inébranlable, une conviction d’autonomie presque militante.
Bien sûr dans une certaine mesure il est vital de se sentir capable d’agir, de décider, de s’orienter… C’est même un marqueur de bonne santé psychique: la sensation d’exister comme sujet, de ne pas être purement objet des circonstances.
Oui, oui! Mais bien souvent, derrière ce discours d’apparente liberté, il y a une illusion il me semble, une illusion qui confond le sentiment de choisir avec la réalité des mécanismes qui conduisent à ces choix…
Il suffit de se poser quelques instants, en silence, pour observer nos pensées, nos réactions, nos élans, il suffit par exemple de se demander « d’où me vient cette envie soudaine de plaire à cette personne? », « pourquoi ai-je tant besoin que mon collègue me valide? », « qu’est-ce qui m’empêche de dire non à cette invitation qui pourtant m’ennuie profondément? » ou encore « combien de mes choix sont le fruit d’une réelle délibération rationnelle, et combien sont des automatismes déguisés en décisions? »…
TRUMP ET LA PATHOLOGIE NARCISSIQUE: QUAND LE POLITIQUE DEVIENT UNE SCÈNE DE TRAUMA…

Je ne vais pas parler ici des aspects politiques.
Je propose de construire notre angle de réflexion sur le fait que simplement évoquer Donald Trump dans un cadre psychologique n’est pas anodin pour de nombreuses personnes. C’est même, dans plus de cas qu’on ne le pense, presque douloureux ou, pour d’autres, insupportable…
Je précise ici que au-delà du personnage public, polarisant et tonitruant, il se dessine une figure bien connue ou trop connue malheureusement, de celles et ceux qui ont côtoyé de près un parent, un conjoint ou un supérieur hiérarchique pathologiquement narcissique. Je ne mentionne pas ici un simple travers de caractère ou un ego surdimensionné mais plutôt un fonctionnement psychique structuré autour du besoin vital de dominer, de briller et de détrui
Pourquoi tant de personnes minimisent-elles les abus?

Cette question on me la pose souvent et elle semble traduire une détresse vécue par de nombreuses victimes d’abus. J’avais déjà un peu abordé cette thématique il y a quelques semaines et je vous propose de continuer la réflexion en répondant rapidement ce matin à la question. Partons d’une situation tellement classique: une victime raconte son histoire et se heurte à des réactions déconcertantes de la part de son interlocuteur du jour, avec des phrases dont on avait déjà parlé ensemble sur ce blog: « ce n’était pas si grave », « il faut tourner la page », »pense au futur il faut aller de l’avant » ou encore « j’te rassure tout le monde a des problèmes »…
J’ai tendance à dire qu’on touche là le degré d’empathie de la limace, et encore…
Mais restons du côté Esprit Psy et tentons de mieux comprendre pourquoi ces phrases peuvent être dites, sans les excuser pour autant car elles restent violentes et/ou culpabilisantes et/ou abandonniques.
Du piège de la relation médicale pour les victimes d’abus

Les personnes ayant connu ou devant suivre un parcours médical au long cours peuvent être confrontées à un sentiment d’inconfort (voire même de détresse) au sein de leur relation avec leur soignant.
La maladie et la douleur créent en nous une posture de faiblesse face à celui «qui sait», celui «qui peut». Cette attente vis-à-vis de l’autre peut être particulièrement difficile pour une personne victime d’abus.Comment ne pas glisser dans la position de l’enfant fragilisé qui attend que le parent sauveur prenne en charge sa souffrance?
Ces attentes, plus ou moins conscientes, créent un profond malaise, qui verra chaque erreur relationnelle du professionnel comme un abus réitéré, un abandon cruel.Le manque de disponibilité, de temps d’écoute, d’empathie et de solutions est pourtant courant chez des professionnels de la santé débordés et épuisés (ou trop techniques et détachés de l’humain).Autant de petits accrocs à la toile de la relation patient/soignant qui peuvent vous porter préjudice dans votre parcours de soins en tant qu’ancienne victime d’abus.
La question qui se poserait naturellement si vous étiez confronté à ce sentiment d’impuissance et d’abus est de savoir comment inverser la tendance pour reprendre prise sur votre parcours médical.Un des meilleurs conseils qui m’a été donné pour faire face aux années de maladie a été de me placer en position de cheffe d’orchestre de mes soins.Coordonner les différents acteurs, faire des comptes rendus écrits des rendez-vous, poser des questions réfléchies à l’avance et prendre des notes, planifier un programme de soins : autant de petites astuces qui changent la dynamique.
D’un patient silencieux en attente, j’ai proposé aux médecins de voir un adulte conscient et aux commandes, en recherche de « prestations » plus que de « protection »
Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Vraiment ?

On aime bien cette phrase dans notre société, comme si la douleur était un professeur exigeant qui forge notre caractère…
Stop! C’est violent en fait ce qui se raconte en ce sens!
Car en réalité, tout ce qui ne nous tue pas peut aussi nous laisser brisés, fatigués, méfiants, etc. Survivre à une épreuve ne signifie pas en ressortir grandi, et parfois malheureusement on en sort juste plus abîmé.
Cette vision simpliste que je critique glorifie la souffrance comme un passage obligé vers la puissance, mais ce n’est pas la douleur qui nous renforce, c’est ce qu’on en fait. Et encore faut-il en avoir les ressources!
Pire encore, cette phrase culpabilise celles et ceux qui souffrent durablement, comme si porter des cicatrices invisibles était un échec!!!
Quel manque d’empathie général! Non?
La plupart des traumatismes ne « forment » pas, désolé pour ceux qui s’accrochent à cette merveilleuse idée, non les traumatismes laissent des fissures profondes et
Se sentir mal d’aller bien…

Aujourd’hui je réponds à une question qui m’est régulièrement posée sous une forme proche de celle-ci: »pourquoi je me sens coupable ou mal quand ça va un peu mieux pour moi? »…
Cette question ouvre plusieurs pistes d’exploration et je vais vous en proposer certaines.
En première approche je dirais que ce sentiment de culpabilité ne surgit pas par hasard, qu’il est bien souvent le produit d’une construction psychologique (issue d’un contexte familial et social) qui façonne notre rapport à la souffrance et au bien-être. La culpabilité peut être généralement associée à des conflits internes et des loyautés inconscientes qui remontent à l’enfance. On parle du surmoi en psychanalyse, rappelons que c’est une instance psychique qui enregistre les interdits et les normes transmises par l’environnement familial et sociétal. Or chez certaines personnes ce surmoi peut devenir particulièrement rigide ce qui peut générer une sensation de »faute imaginaire » dès lors qu’elles accèdent à un état de bien-être. Prenons l’exemple d’un enfant qui a grandi dans une famille marquée par la souffrance, la maladie ou la précarité par exemple, une thérapie analytique peut mettre en lumière que cet individu aura assimilé l’idée que la douleur est un mode de vie légitime, voire une preuve de loyauté envers sa famille… Et que donc adulte, il peut se heurter à un conflit intérieur: »si je vais bien, est-ce que je trahis mes parents qui ont tant souffert? »… Cette culpabilité agirait alors comme une dette invisible où le bien-être semble devoir être payé d’un prix, comme si le bonheur était finalement un luxe auquel on ne peut prétendre sans en subir les conséquences! Merci la famille…
Maintenant au-delà de l’individu, certaines familles et environnements sociaux peuvent véhiculer un message implicite selon lequel »s’en sortir », c’est rompre un pacte tacite de solidarité dans la souffrance. Régulièrement en travail thérapeutique je peux observer que si dans une fratrie l’un des membres reste dans la difficulté, la personne en analyse qui parvient peu à peu à s’épanouir pourra parallèlement éprouver un profond malaise: »pourquoi moi et pas mon frère ou ma sœur? »… Et il m’apparaît que ce type de culpabilité reste particulièrement marqué dans les familles où la résilience individuelle est perçue comme une forme d’égoïsme ou de trahison envers le collectif ( »tu n’as pas le droit d’aller mieux que nous » reste le message implicite).
Etre gentil ou gentille ne protège pas contre l’abus

On grandit souvent avec l’idée que la gentillesse est une protection, qu’en étant une personne bienveillante, patiente et compréhensive, on finira par être traité(e) de la même manière.
On nous répète que l’amour adoucit les cœurs, que la tolérance désamorce les conflits et que si l’on fait preuve de suffisamment de bonté l’autre finira par changer…
Ha oui, et j’oubliais: il faut pardonner, évidemment.
Mais toutes ces croyances forment un piège.
Car la gentillesse ne protège pas des manipulateurs, elle les alimente !
Elle ne désarme pas les abuseurs, elle leur donne une arme supplémentaire.
Un manipulateur ne voit pas la douceur comme une vertu mais comme une faille exploitable!
Un pervers ne ressent aucune culpabilité face à la bienveillance, il l’écrase avec jouissance !!!
Un abuseur ne se demande pas s’il va trop loin, il testera juste jusqu’où il peut aller, peu importe le coût pour vous…
Pourquoi certaines blessures restent vives? (quand le passé ne passe pas…)

Donc pour point de départ, partons de ce qu’il m’arrive assez souvent quand des patients (anciennes victimes d’abus notamment) me regardent avec une vive douleur en me disant: « je pensais que j’avais tourné la page… mais il a suffit d’un mot (d’une odeur, d’un visage, d’un cauchemar, etc.) pour que tout revienne comme si c’était hier! »
C’est un peu comme une sensation d’être brutalement ramené(e) dans un passé douloureux comme si aucune distance ne s’était finalement créée. Aujourd’hui je vous propose de poser quelques mots pour comprendre ce phénomène qui semble »figer » certaines blessures dans le temps. En fait la réponse se trouve au cœur même du fonctionnement de notre cerveau, entre mémoire émotionnelle, circuits neuronaux et construction psychique. Il faut savoir que lorsqu’un événement marquant survient, notre cerveau ne l’enregistre pas comme un simple souvenir parmi d’autres: il mobilise un réseau complexe qui implique l’amygdale (structure clé de notre cerveau limbique qui agit comme une alarme émotionnelle) et l’hippocampe (on peut dire en caricaturant qui sert d’archiviste et de cartographe temporel). En situation de danger ou de stress intense l’amygdale prend le dessus et encode l’événement avec une charge émotionnelle brute tandis que l’hippocampe, souvent perturbé par le stress, peine à lui donner un contexte clair et linéaire. Résultat malheureux: ces souvenirs traumatiques restent stockés sous une forme sensorielle et émotionnelle intense souvent déconnectée du fil du temps. D’où cette impression que la douleur peut ressurgir avec la même intensité comme si elle venait tout juste de se produire.