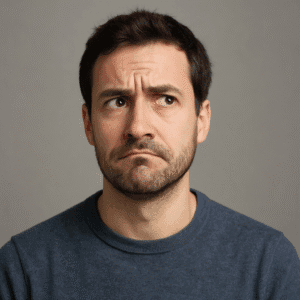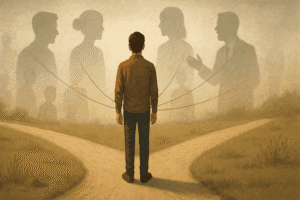Quand vous décidez d’ignorer ceux qui vous blessent, vous enlevez une grande partie de leur pouvoir ?
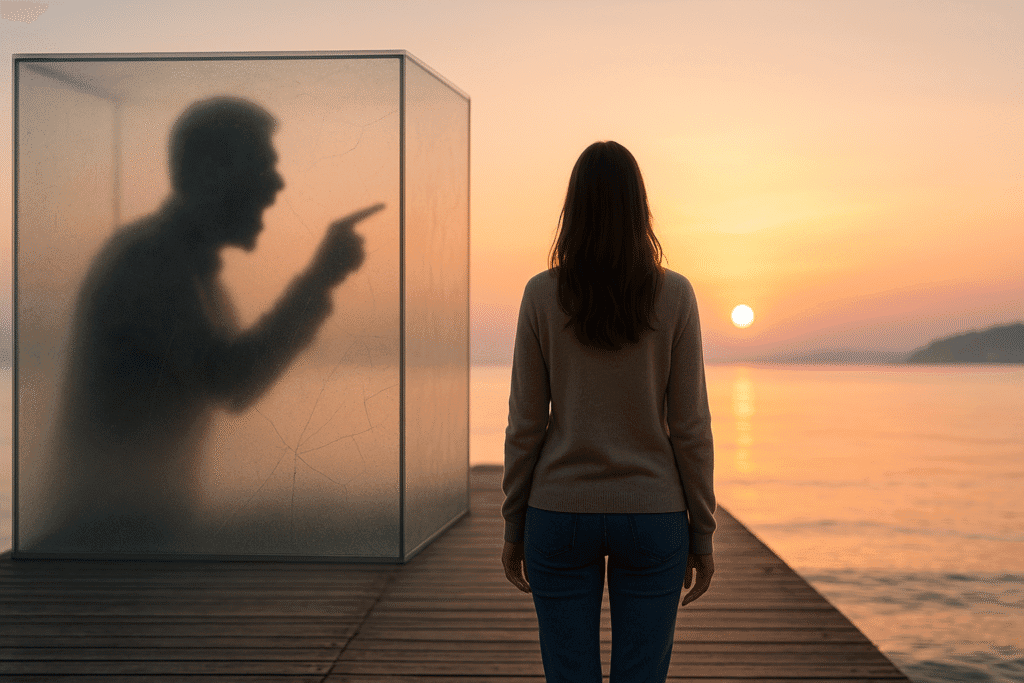
Cette phrase, croisée sous différentes formes sur les réseaux sociaux, m’a paru intéressante:
« Quand vous décidez d’ignorer ceux qui vous blessent, vous enlevez une grande partie de leur pouvoir. »
Sur le papier, cela semble libérateur.
Mais dans la réalité psychique des personnes blessées, cette « stratégie » peut parfois s’avérer bien plus limitée qu’elle n’en a l’air.
Peut-être faut-il y voir des degrés, même si la phrase est lancée à tous et toutes comme une vérité…
Au degré initial, il me semble que cette phrase peut fonctionner quand on est finalement peu attaché à la personne qui nous blesse. Il semble alors assez facile pour la plupart des gens de « passer à autre chose » pour reprendre cette expression que j’entends souvent. Cela peut-être le cas dans les relations de travail, dans le cercle d’amitié ou dans une relation plus intime si elle s’avère peu impliquante pour l’individu.
Et ensuite, un autre degré peut apparaître, je parle ici des relations plus impliquantes émotionnellement, par exemple les relations avec sa famille ou une relation avec un conjoint où l’on s’est émotionnellement impliqué(e).
« Ignorer » peut être compris comme un mécanisme de défense, que j’encourage d’ailleurs souvent pour mes patients s’ils ressentent que cela pourrait leur apporter un mieux être émotionnel, notamment face à des figures violentes ou non respectueuses. Mettre à distance, c’est pour beaucoup une manière de reprendre un peu de pouvoir dans une relation déséquilibrante, de souffler, de se mettre à l’abri de l’autre, etc.
Mais il serait ambitieux de penser que « décider d’ignorer » suffit à enlever le pouvoir psychique que ces personnes ont pu exercer où exercent encore. Car leur emprise ne réside pas tant dans leur présence actuelle que dans les traces qu’elles laissent à l’intérieur de soi.
Ignorer quelqu’un en sortant de son cercle d’influence et d’interaction est souvent un point d’ancrage pour mettre une limite, se légitimer et bien entendu se protéger, mais cela ne supprime pas pour autant les blessures, les symptômes post-traumatiques, les préjud
Le sentiment « d’être nul(le) »

Je vous propose une rapide réflexion sur un sentiment que je croise bien souvent. Si je pars de mon expérience quotidienne, je dirais qu’il y a de nombreuses personnes pleines de qualités, par exemple sensibles et bienveillantes, qui vivent pourtant avec une impression sourde et tenace d’être nulles.
Le terme »nul » peut apparaître choquant, car il l’est, mais c’est pourtant le terme entendu directement dans les discours que les personnes concernées effectuent à propos d’elles-mêmes. Et les facettes jugées si durement sont multiples: par exemple, nulles dans leurs décisions, nulles dans leurs relations, nulles dans leur façon d’exister, nulles dans leur personnalité, nulles dans leur carrière, etc.
Ce sentiment n’est par ailleurs pas toujours aussi explicitement exprimé pour d’autres personnes, il peut s’insinuer et saboter les élans dans de nombreux domaines. Par exemple, ce sentiment diffus pourra murmurer en soi, au moment de se lancer dans une expérience ou un projet « tu ne vas pas y arriver » ou « tu ne le mérites pas »!
C’est ce type de sentiment qui peut aussi diffuser à bas bruit quand quelqu’un vous félicite « s’il savait vraiment, il penserait autrement »… Et bien souvent je le perçois aussi dans les discours à l’endroit des réussites de la personne: « j’ai juste eu de la chance!”
Même si je suis bien conscient que permettre à une personne de sortir des schémas auto-agressifs prend du temps et souvent nécessite un chemin thérapeutique, j’aimerais proposer, dans ce billet, à celles et ceux qui vivent avec cette perception d’eux-mêmes, que ce sentiment n’est pas une preuve et que ce n’est pas un fait objectif non plus!
C’est une mémoire émotionnelle, une empreinte ancienne et je vous propose ici quelques éléments permettant d’explorer
« Tu exagères! » … un révélateur?

Quand dans un couple ou en famille cette petite phrase sort, « Tu exagères! », il faut bien saisir ce qui se joue souvent dans la dynamique relationnelle quand quelqu’un exprime ses émotions ou ressentis…
Alors si elle peut sembler anodine à première vue, elle m’apparaît pourtant redoutablement efficace pour invalider en douceur (mais pas que, elle peut cacher parfois une véritable brutalité passive!) ce qui, chez l’autre, relève d’un vécu subjectif, d’un ressenti authentique.
Il y a bien souvent négation de soi quand cette phrase nous est adressée.
Réfléchissons-y, on pourrait croire dans la conversation qu’il ne s’agit que d’un malentendu sur l’intensité, d’un désaccord sur la perception d’un événement… Mais il me semble en réalité que cette phrase devient souvent un poison lent. Elle est souvent ce que j’appelle un sommet d’iceberg éclairant car elle pointe par expérience une posture toxique dans la relation.
La petite exclamation, « Tu exagères! » a ceci de puissant dans la bouche d’un interlocuteur (un parent, un conjoint, un collaborateur, une amie ..) qu’elle transforme une émotion légitime en faute morale, un mal-être en théâtre, une réaction humaine en pathologie imaginaire.
« Tu exagères » ne dit pas seulement « tu ressens fort », elle sous-entend « ce que tu ressens n’a pas de valeur à mes yeux », « ta réalité n’est pas fiable », « ton émotion dérange », etc.
Et il suffit de l’entendre un certain nombre de fois pour finir par se taire!
Cette phrase attaque la confiance en soi, la légitimité et façonne les places et les rôles sociaux si on n’y prend pas garde…
Pourquoi tant de personnes minimisent-elles les abus?

Cette question on me la pose souvent et elle semble traduire une détresse vécue par de nombreuses victimes d’abus. J’avais déjà un peu abordé cette thématique il y a quelques semaines et je vous propose de continuer la réflexion en répondant rapidement ce matin à la question. Partons d’une situation tellement classique: une victime raconte son histoire et se heurte à des réactions déconcertantes de la part de son interlocuteur du jour, avec des phrases dont on avait déjà parlé ensemble sur ce blog: « ce n’était pas si grave », « il faut tourner la page », »pense au futur il faut aller de l’avant » ou encore « j’te rassure tout le monde a des problèmes »…
J’ai tendance à dire qu’on touche là le degré d’empathie de la limace, et encore…
Mais restons du côté Esprit Psy et tentons de mieux comprendre pourquoi ces phrases peuvent être dites, sans les excuser pour autant car elles restent violentes et/ou culpabilisantes et/ou abandonniques.
Du piège de la relation médicale pour les victimes d’abus

Les personnes ayant connu ou devant suivre un parcours médical au long cours peuvent être confrontées à un sentiment d’inconfort (voire même de détresse) au sein de leur relation avec leur soignant.
La maladie et la douleur créent en nous une posture de faiblesse face à celui «qui sait», celui «qui peut». Cette attente vis-à-vis de l’autre peut être particulièrement difficile pour une personne victime d’abus.Comment ne pas glisser dans la position de l’enfant fragilisé qui attend que le parent sauveur prenne en charge sa souffrance?
Ces attentes, plus ou moins conscientes, créent un profond malaise, qui verra chaque erreur relationnelle du professionnel comme un abus réitéré, un abandon cruel.Le manque de disponibilité, de temps d’écoute, d’empathie et de solutions est pourtant courant chez des professionnels de la santé débordés et épuisés (ou trop techniques et détachés de l’humain).Autant de petits accrocs à la toile de la relation patient/soignant qui peuvent vous porter préjudice dans votre parcours de soins en tant qu’ancienne victime d’abus.
La question qui se poserait naturellement si vous étiez confronté à ce sentiment d’impuissance et d’abus est de savoir comment inverser la tendance pour reprendre prise sur votre parcours médical.Un des meilleurs conseils qui m’a été donné pour faire face aux années de maladie a été de me placer en position de cheffe d’orchestre de mes soins.Coordonner les différents acteurs, faire des comptes rendus écrits des rendez-vous, poser des questions réfléchies à l’avance et prendre des notes, planifier un programme de soins : autant de petites astuces qui changent la dynamique.
D’un patient silencieux en attente, j’ai proposé aux médecins de voir un adulte conscient et aux commandes, en recherche de « prestations » plus que de « protection »
Etre gentil ou gentille ne protège pas contre l’abus

On grandit souvent avec l’idée que la gentillesse est une protection, qu’en étant une personne bienveillante, patiente et compréhensive, on finira par être traité(e) de la même manière.
On nous répète que l’amour adoucit les cœurs, que la tolérance désamorce les conflits et que si l’on fait preuve de suffisamment de bonté l’autre finira par changer…
Ha oui, et j’oubliais: il faut pardonner, évidemment.
Mais toutes ces croyances forment un piège.
Car la gentillesse ne protège pas des manipulateurs, elle les alimente !
Elle ne désarme pas les abuseurs, elle leur donne une arme supplémentaire.
Un manipulateur ne voit pas la douceur comme une vertu mais comme une faille exploitable!
Un pervers ne ressent aucune culpabilité face à la bienveillance, il l’écrase avec jouissance !!!
Un abuseur ne se demande pas s’il va trop loin, il testera juste jusqu’où il peut aller, peu importe le coût pour vous…
Pourquoi certaines blessures restent vives? (quand le passé ne passe pas…)

Donc pour point de départ, partons de ce qu’il m’arrive assez souvent quand des patients (anciennes victimes d’abus notamment) me regardent avec une vive douleur en me disant: « je pensais que j’avais tourné la page… mais il a suffit d’un mot (d’une odeur, d’un visage, d’un cauchemar, etc.) pour que tout revienne comme si c’était hier! »
C’est un peu comme une sensation d’être brutalement ramené(e) dans un passé douloureux comme si aucune distance ne s’était finalement créée. Aujourd’hui je vous propose de poser quelques mots pour comprendre ce phénomène qui semble »figer » certaines blessures dans le temps. En fait la réponse se trouve au cœur même du fonctionnement de notre cerveau, entre mémoire émotionnelle, circuits neuronaux et construction psychique. Il faut savoir que lorsqu’un événement marquant survient, notre cerveau ne l’enregistre pas comme un simple souvenir parmi d’autres: il mobilise un réseau complexe qui implique l’amygdale (structure clé de notre cerveau limbique qui agit comme une alarme émotionnelle) et l’hippocampe (on peut dire en caricaturant qui sert d’archiviste et de cartographe temporel). En situation de danger ou de stress intense l’amygdale prend le dessus et encode l’événement avec une charge émotionnelle brute tandis que l’hippocampe, souvent perturbé par le stress, peine à lui donner un contexte clair et linéaire. Résultat malheureux: ces souvenirs traumatiques restent stockés sous une forme sensorielle et émotionnelle intense souvent déconnectée du fil du temps. D’où cette impression que la douleur peut ressurgir avec la même intensité comme si elle venait tout juste de se produire.
Paranoïa… ha bon??

Dans le langage courant, le terme « paranoïa » est souvent utilisé de manière approximative, comme s’il s’agissait simplement d’un excès de méfiance ou d’un trait de personnalité exacerbé. Pourtant rappelons-nous que derrière ce mot se cache parfois une immense souffrance psychologique et que lorsqu’il s’inscrit dans un cadre psychopathologique, notamment dans sa forme décompensée, il peut conduire à une altération majeure du lien à l’autre.
En écoutant les récits de nombreuses personnes ayant vécu des abus j’ai souvent constaté qu’elles pouvaient spontanément employer ce terme »paranoïa » pour qualifier leur méfiance intense vis-à-vis des autres. Mais à bien les entendre, il m’apparaît que ce qu’elles désignent par « paranoïa » relève bien plus souvent d’une hypervigilance liée à des expériences traumatiques que d’un véritable délire paranoïaque structuré. Il ne s’agit donc pas, dans la majorité des cas, d’une psychose paranoïaque au sens psychiatrique du terme, mais bien plutôt d’un mécanisme de protection souvent envahissant et qui altère il me semble la perception du monde et des intentions d’autrui.
Alors sans entrer dans une exploration clinique approfondie, je vous propose ici de nous arrêter quelques lignes sur cette expérience que beaucoup de mes patients traversent: cette »sensation » que tout devient suspect, que le silence d’un proche dissimule un reproche, qu’un regard contient une intention cachée, que le monde est finalement rempli de messages à décoder… Ce type de pensée se construit souvent sur un socle de blessures profondes et d’expériences passées où la confiance a été brisée (bien souvent en lien avec des figures parentales défaillantes). Pour simplifier je dirais que l’esprit cherche à éviter de revivre la douleur d’une désillusion et »préfère » (mécanisme de défense) alors se tenir en alerte permanente pour scruter le moindre signe de menace.
Mais cette vigilance, à force d’être constante, ne protège plus: elle enferme. Car à voir des pièges partout la personne se retrouve très souvent seule, fatiguée par une forte charge mentale, enfermée dans un monde où elle se sent à la fois persécutée et incomprise. C’est bien entendu une autre conséquence injuste subie par la personne qui a déjà vécu un (des) traumatisme(s).
J’ai souvent observé que cette méfiance exacerbée s’articule finalement autour d’un besoin profond de contrôle, comme si anticiper le pire pouvait éviter une nouvelle blessure (je ne développerai pas ici les aspects neurobiologiques mais il y a beaucoup à creuser du côté du cortex préfrontal et de l’amygdale cérébrale en lien avec les conséquences neurobiologiques des traumatismes).
Sur le chemin thérapeutique, il s’agit de permettre aux personnes aux prises avec cette hypervigilance de concevoir que l’apaisement ne réside pas dans la certitude d’avoir raison sur le danger, mais bien plus dans la possibilité même de questionner cette peur!
Les souvenirs douloureux qui ressurgissent d’un coup… Tourner la page?!

Beaucoup de personnes en témoignent, il peut arriver parfois qu’un souvenir refasse d’un coup surface chargé d’une émotion brute, presque comme s’il venait de se produire. Une sorte de retour violent du passé.
Je rappelle ici que la mémoire n’est pas un simple catalogue figé de nos expériences et dont le classement se fait de manière standardisée pour tous les évènements. Un souvenir douloureux peut rester hors du champ de la conscience sans jamais disparaitre vraiment, il peut être enfoui, mis en veille, mais il ne cesse pas d’exister pour autant. Freud parlait du retour du refoulé, cette idée que ce qui a été trop difficile à affronter au moment où cela s’est produit peut être mis de côté par le psychisme, non pas effacé, mais relégué dans l’ombre, en attente d’un moment où il pourra émerger.
Les neurosciences confirment aujourd’hui ce que la psychanalyse avait ainsi déjà entrevu: les souvenirs liés à des expériences traumatiques ne sont pas stockés dans le cerveau de la même manière que les souvenirs neutres ou heureux. Dans un contexte de stress intense, l’amygdale, structure cérébrale impliquée dans la gestion des émotions, s’active fortement, tandis que l’hippocampe, qui est responsable de l’intégration cohérente des souvenirs, peut voir son fonctionnement altéré (parfois très fortement). Résultat: l’événement est fragmenté, dissocié et parfois même inaccessible à la conscience jusqu’au jour où un élément (ça peut être une odeur, un son, un lieu, une sensation, etc.) vient raviver ce qu’on pourrait appeler la »trace latente » du souvenir. Et cela peut être très perturbant pour la
La perversion devient-elle la règle? Le mensonge un détail?

La liberté d’expression est sans doute l’une des valeurs les plus fondamentales d’une société démocratique mais il me semble qu’un glissement dangereux s’opère lorsqu’elle est invoquée non plus comme un droit au débat, à l’échange d’idées ou à la critique constructive, mais comme un bouclier servant à protéger le mensonge, la manipulation et la diffamation.
Car dire n’est pas mentir, s’exprimer n’est pas calomnier et pourtant, nous assistons à une étrange mutation du discours où certains revendiquent leur « liberté » non pas pour enrichir le débat, mais pour imposer des contre-vérités, sans contradiction possible.
Et lorsqu’une limite leur est opposée pour rappeler qu’une parole a des conséquences, qu’un mensonge délibéré nuit à autrui ou qu’une diffamation détruit des vies, ces mêmes individus se replient sur une posture victimaire. Ils deviennent « persécutés par le système », « réduits au silence par la censure », « interdits de dire ce que les autres ne veulent pas entendre ».
Il ne faut pas hésiter à dénoncer cette mécanique perverse qui repose sur le processus d’inversion victimaire.