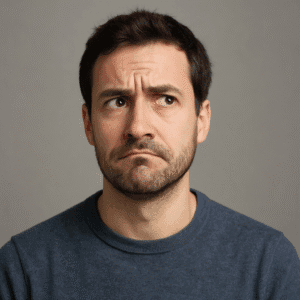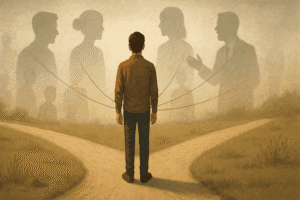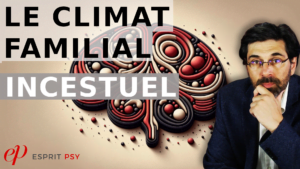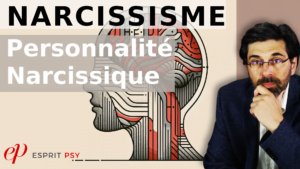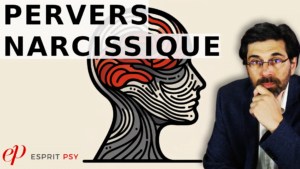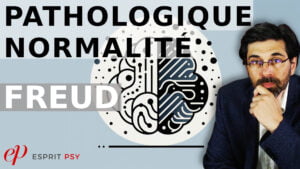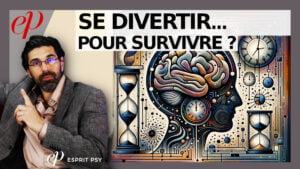"Les gens ne changent pas, ils n’ont simplement jamais été comme vous les imaginiez..."
« Les gens ne changent pas, ils n’ont simplement jamais été comme vous les imaginiez… »
J’ai vu passer cette citation sur un réseau social et je vous propose une réaction possible.
Il y a dans cette citation, il me semble, un côté heurtant en la lisant, non pas tant par ce qu’elle dit des autres, mais bien par ce qu’elle souhaite révéler de nous-mêmes.
Et puis aussi elle semble porter un jugement définitif sur la nature humaine: « les gens ne changent pas! »
N’empêche, très vite l’angle peut se recaler dans notre esprit: ce ne sont pas eux le problème, c’est notre perception!
Ce que cette phrase insinue, c’est que la douleur ressentie face à une désillusion relationnelle vient moins de la transformation de l’autre que de l’effondrement d’une image mentale que nous avions construite. Puissant!
J’avoue que pour beaucoup de personnes en souffrance au sein de relations toxiques ( famille, conjoint, travail, etc.), c’est justement tout l’enjeu d’un chemin de libération de l’autre qui pourrait se résumer ici dans cette citation… Chemin que j’accompagne pour les personnes qui s’allongent sur mon divan.
Parce que c’est là que le travail du psychanalyste commence: interroger les projections, mettre à nu les fantasmes qui organisent la réalité subjective…
Bien souvent les douleurs relationnelles les plus vives ne sont pas causées par ce que l’autre nous a fait, mais par ce que nous croyions qu’il ne ferait jamais! Nous sommes souvent abîmés, voire détruits, par le fait que l’autre puisse faire ce que nous pensions impossible qu’il fasse (je parle ici sur le plan affectif seulement et non pas sur les dégâts neurobiologiques liés aux violences par exemple et aux stress chroniques de systèmes d’abus).
C’est comme si une croyance (souvent forgée dans la relation parent-enfant ou entre conjoints) soutenait tout un édifice de sens et quand elle s’effondre, c’est notre monde intérieur qui vacille.
Explorons quelques pistes de réflexion autour de cette idée en commençant par l’angle des projections. Je rappelle qu’en psychanalyse la notion de projection désigne un mécanisme de défense par lequel une personne attribue à autrui des pensées, des sentiments ou des intentions qui lui appartiennent en propre. Mais au-delà de cette fonction défensive, la projection structure aussi notre lien à l’autre et ce dès les premiers instants de la vie: un bébé ne voit pas la mère telle qu’elle est, il voit une figure capable de satisfaire ses besoins! Parce qu’il ne perçoit pas encore l’altérité, il va percevoir l’autre comme un prolongement de lui-même. Et on peut dire que c’est en cela que le développement psychique est une désillusion progressive, car il faut apprendre que l’autre est un autre, qu’il a ses limites, ses absences, ses failles! Diable! 
Et de nombreux esprits n’ont pas pu atteindre une maturité dans cette perspective de désillusions (et je renvoie à l’ouvrage de Racamier pour poursuivre, entre autres, la réflexion sur cette piste: le deuil originaire). Alors pas tous bien sûr, mais il me semble que beaucoup d’adultes continuent de vivre les relations comme des scénarios inconscients, forgés suivant le niveau de non-désillusions de l’enfance, dans lesquels les autres doivent au final jouer un rôle: le sauveur, le protecteur, le fidèle, le bienveillant, l’être pur, etc.
Et c’est parfois le moindre écart de comportement qui peut alors être interprété non pas comme une variation humaine, mais comme une trahison de la fiction. Dans ces cas-là, l’autre n’a pas changé, il a seulement cessé de correspondre au rôle que nous lui avions assigné…
Prenons un autre angle maintenant, celui du traumatisme, où lorsque l’on découvre que l’autre n’est pas ce que l’on croyait, la douleur peut être vive, fulgurante, parfois/souvent comparable à un deuil. Et ce n’est pas un hasard car ce que l’on perd dans ces moments-là, ce n’est pas seulement la relation, c’est aussi une part de soi: je parle du soi rêvant, espérant, croyant, aimant… Le voilà qui s’effondre!
Il faut alors composer avec ce vide vertigineux, celui laissé par une image idéalisée que l’on nourrissait parfois depuis des années…
Dans ma pratique, il m’arrive souvent d’entendre cette phrase: ”Il a changé, je ne le reconnais plus.”
Mais très souvent, en revisitant l’histoire, on réalise que les indices étaient là dès le départ! Bien souvent il apparaît que notre esprit les a ignorés, minimisés, réinterprétés pour ne pas nuire, semble-t-il, à la cohérence du fantasme dont nous nous nourrissions… On avait besoin que l’autre soit par exemple bon, fidèle, loyal, amoureux, incapable de faire du mal, et ce besoin était si fort qu’il écrasait la réalité.
Et quand la réalité surgit, elle n’est pas simplement décevante, elle est souvent vécue humiliante car elle nous confronte à notre propre aveuglement par cette question sourde: ”Comment ai-je pu ne pas voir?!”…
C’est là où nous apprenons beaucoup de nous-mêmes en apprenant par exemple à faire la distinction sur le divan entre nos désirs conscients, nos besoins automatisés et nos mécanismes défensifs d’enfance encore en activité…
Parlons un peu maintenant de l’idéalisation dans nos liens en rappelant déjà que l’idéalisation apparaît comme un processus naturel (les esprits les plus sarcastiques pourraient souffler « et nécessaire »…) dans la construction du lien affectif.
Pour faire simple, l’idéalisation c’est ce qui nous permet, au début d’une relation amoureuse par exemple, de nous sentir transportés, nourris, profondément connectés… Mais cette idéalisation est suivie d’un processus de désidéalisation progressive où l’on « accepte » de voir l’autre tel qu’il est, avec ses incohérences, ses limites, ses zones d’ombre parfois…
Quand ce processus ne se fait pas ou quand il est brutalement interrompu par un événement révélateur (une trahison, un mensonge, une rupture), c’est souvent là que la chute est vertigineuse! Ce n’est plus seulement l’autre que l’on accuse, c’est soi que l’on juge pour avoir cru, et parfois, notre esprit préfère d’ailleurs continuer à croire, à rationaliser, à nier l’évidence, pour éviter cette souffrance…
Mais au final, l’idéalisation peut alors entraîner malgré soi à une perte de confiance en soi ou d’estime de soi car plus que la douleur de la trahison de l’autre, on peut être amené ensuite à douter de soi par cette dimension que l’on sent nous échapper en soi et qui a été mise au grand jour: la part des automatismes déterminants…
Plus généralement, au-delà de l’idéalisation, c’est souvent difficile de voir les gens tels qu’ils sont et non tels que nous voulons qu’ils soient, car cela suppose de tolérer l’angoisse de la complexité, de la contradiction, de l’ambiguïté, de la trahison, etc. C’est d’autant plus difficile pour nos esprits que cela suppose de renoncer à l’idée que l’amour ou l’amitié nous protègent de tout (besoin d’un amour inconditionnel…).
Et nous comprenons au passage aisément, en référence aux illusions-armures qui peuvent se tisser inconsciemment dans de nombreux systèmes familiaux toxiques, qu’un esprit d’enfant ne puisse pas supporter cette réalité et qu’il s’en protège.
Nos illusions nous permettent de croire en un monde plus stable, plus fiable, plus prévisible, au risque parfois de devenir trop rigides et incapables d’intégrer les signaux d’alerte.
Pour celles et ceux qui ont pu s’y confronter sur le divan ou ailleurs, vous reconnaîtrez sans doute que je commence ici à me rapprocher de la notion de clivage lorsqu’un individu sépare deux représentations incompatibles: d’un côté l’image idéalisée de l’autre, et de l’autre les preuves tangibles de son comportement destructeur.
Ce clivage peut durer des années et il permet de survivre à une réalité psychique trop menaçante. Mais tôt ou tard, la réalité s’impose et avec lui le choc!
Et encore ce n’est pas l’autre qui a changé, c’est notre système défensif qui s’est modifié pour nous permettre de connecter à la réalité.
Alors on peut mieux saisir pourquoi cette phrase « les gens n’ont jamais été comme vous les imaginiez » résonne comme une provocation et peut nous heurter!
J’imagine que vous ne serez sans doute d’ailleurs pas nombreux à lire ces lignes jusqu’ici tant le sujet peut être épidermique…
Cette phrase nous appelle à nous interroger sur notre manière de nous attacher, de faire confiance, d’aimer, elle nous pousse à reconnaître que notre perception est toujours colorée par notre histoire, nos blessures, nos attentes…En cela c’est presque un programme de chemin thérapeutique!
Cette phrase peut revêtir ceci de malaisant qu’elle nous invite, presque comme une évidence insultante, à voir l’autre tel qu’il est, à accepter qu’il puisse nous décevoir, nous blesser, et peut-être aussi nous surprendre, nous inspirer, précisément parce qu’il échappe à notre contrôle…
Cette fichue citation nous renvoie à une maturité affective qui ne repose plus sur l’idéalisation ou autre mécanisme défensif ou besoin de validation externe…
Je précise que cela ne signifie sans doute pas devenir cynique ou méfiant par essence, mais plus en position d’observer, d’écouter, de ressentir sans tout de suite interpréter ou catégoriser. Cela signifie aussi se poser cette question pertinente à mon sens: « Ce que je vois en l’autre, est-ce vraiment lui, ou est-ce mon propre besoin d’être aimé(e), sécurisé(e), reconnu(e)? »…
![]()
Je vous propose ici quelques articles et vidéos sur des sujets qui pourraient vous intéresser:
- Agressions sexuelles et harcèlement en France
- Pourquoi sommes-nous influençables? – L’influence sociale
- La soumission à l’autorité – Quelques réflexions à la suite des conclusions de Milgram
- La valorisation du travail, une injustice sociale?
- Le conformisme (Psychologie Sociale)
- Familles incestuelles (Emprise, intrusions & abus narcissiques): INCESTE MORAL

- Conséquences du climat familial incestuel: Inceste moral et traumatismes subis

- Narcissisme et personnalité narcissique toxique

- PERVERS NARCISSIQUE (profil et mécanismes)

- ÊTRE NORMAL, C’EST QUOI ? PATHOLOGIQUE vs NORMALITÉ

- Philo/Psycho – S’abrutir l’esprit malgré soi: divertissement vs temps de loisir

![]()
Tous droits réservés – © William Milliat / Esprit Psy
![]()

Cette phrase, croisée sous différentes formes sur les réseaux sociaux, m'a paru intéressante:
"Quand vous décidez d'ignorer ceux qui vous blessent, vous enlevez une grande partie de leur pouvoir."Sur le papier, cela semble libérateur.
Mais dans la réalité psychique des personnes blessées, cette "stratégie" peut parfois s’avérer bien plus limitée...

Cette phrase que j'ai croisée sur les réseaux sociaux, "tu ne peux pas coller des ailes sur une chenille et appeler ça un papillon. Le changement doit venir de l’intérieur", nous propose une jolie métaphore pour illustrer le travail thérapeutique il me semble.
En tout cas c'est sur cet axe que je vous propose cette réflexion.Tout particulièrement...

Je vous propose une rapide réflexion sur un sentiment que je croise bien souvent. Si je pars de mon expérience quotidienne, je dirais qu'il y a de nombreuses personnes pleines de qualités, par exemple sensibles et bienveillantes, qui vivent pourtant avec une impression sourde et tenace d’être nulles.
Le terme ''nul'' peut apparaître choquant, car il...

Partons de ce petit texte, largement diffusé sur les réseaux et qui met en avant une posture protectrice face à la maltraitance relationnelle:
"Si quelqu'un te traite mal, souviens-toi juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne, et non chez toi. Les gens normaux ne cherchent pas à détruire les autres."Quand on ce texte on peut...
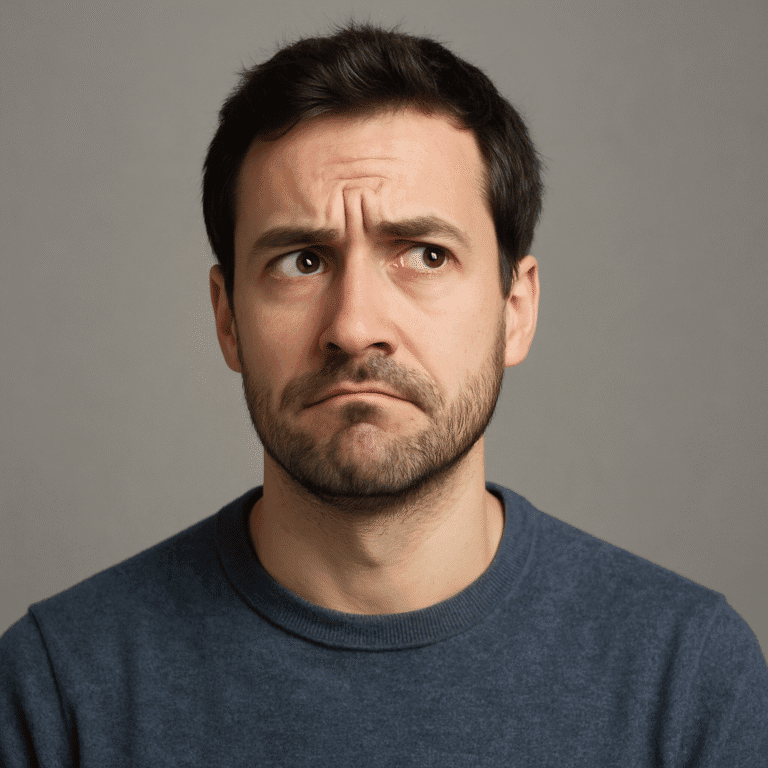
Les études en psychologie ne sont pas que l'étude des comportements ou de la psychopathologie par exemple. On y étudie également, surtout pendant les années de Licence, les statistiques.
Cela permet entre autres, si l'on s'intéresse à la matière, de retenir que quand la science dit "peut-être", il n'y a jamais à entendre "c’est sûr"…
Car autrement cela...
No posts found